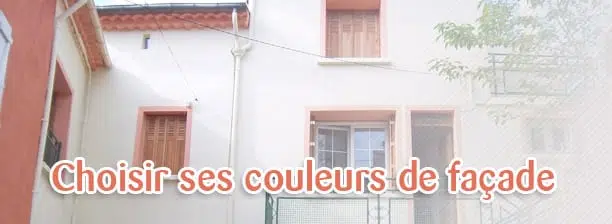Un chiffre brut, sans fard : 70 %. C’est la proportion maximale qu’une banque acceptera parfois de retenir d’un revenu locatif meublé lors d’une demande de prêt immobilier. Les primes exceptionnelles, elles, n’ont droit de cité que si elles reviennent fidèlement depuis plusieurs années. Quant au contrat à durée déterminée, il n’est plus un interdit absolu, à condition de pouvoir démontrer une trajectoire professionnelle solide dans le même secteur. Face à cette mosaïque de règles bancaires, l’accès au crédit se révèle bien plus opaque qu’on ne l’imagine.
Comprendre la capacité d’emprunt : ce que les banques regardent vraiment
La capacité d’emprunt se construit sur trois leviers : stabilité des revenus, respect du taux d’endettement et existence d’un apport. Rien à voir avec une simple lecture de chiffres sur une fiche de paie : chaque ligne, chaque détail de la situation financière, sont passés au crible. C’est l’ensemble, fidèle et cohérent, qui pèse dans la balance.
Le fameux taux d’endettement s’impose comme garde-fou : la majorité des banques fixe la limite à 35 %, en incluant l’assurance. Concrètement, la mensualité du crédit ne peut pas dépasser ce tiers des revenus nets. Prêts en cours, pensions, loyers dus… tout compte, rien n’est laissé au hasard.
L’apport personnel envoie, lui, un signal fort au prêteur. Il faut tabler sur au moins 10 % du montant total (hors frais annexes). Plus l’apport est conséquent, plus la banque se sent rassurée. Cette marge peut ouvrir la porte à de meilleures conditions d’emprunt, en taux comme en durée.
Au-delà du salaire, c’est le profil emprunteur dans toute sa complexité qui est analysé : âge, situation professionnelle, discipline dans la gestion des comptes, rythme d’épargne. Un salarié débutant mais régulier n’affiche pas le même profil qu’un indépendant dont les revenus varient d’un mois à l’autre. Tout est pesé, le détail compte.
Quels types de revenus sont pris en compte pour un prêt immobilier ?
La banque ne dévie pas de son exigence d’examiner la source des revenus pour prêt immobilier. En première ligne, les salaires issus d’un CDI, gage de continuité. Les fonctionnaires marquent aussi de précieux points grâce à leur statut. Les bulletins de paie, la régularité des versements et la nature des primes sont étudiés sans relâche.
Mais les revenus de salariés ne sont pas seuls sur la table. Professions libérales, entrepreneurs, indépendants… Lorsqu’il s’agit de revenus non salariés, la banque réclame d’emblée plusieurs exercices de bilans comptables. L’enjeu : vérifier stabilité et pérennité de l’activité.
Les revenus locatifs ne sont pas oubliés, à condition d’afficher au moins six mois d’historique. Pour prévenir les aléas, la banque applique une décote : 70 à 80 % des loyers, pas davantage. L’objectif reste de garantir la capacité à rembourser, même si l’appartement reste vide quelques semaines.
Pour certaines banques, les revenus financiers réguliers peuvent également entrer dans le calcul : dividendes, pensions, rentes, allocations, tout doit être stable et traçable.
Voici les grandes familles de revenus dont tiennent compte les banques lors de l’évaluation du dossier :
- Salaire en CDI ou en fonction publique
- Revenus non salariés (honoraires, bénéfices, etc.)
- Revenus locatifs rentrant régulièrement
- Revenus financiers à caractère stable
Cette diversité de ressources renforce la capacité d’emprunt. Ce qui compte au final, c’est la régularité, le montant et la visibilité du revenu sur plusieurs années, toujours ramenés au seuil du taux d’endettement.
Calcul de la capacité d’emprunt : méthodes et exemples concrets
Le calcul de la capacité d’emprunt obéit à un principe clair autour du taux d’endettement. La barre est généralement fixée à 35 %, assurance incluse. En pratique, cela signifie que le total de toutes les mensualités de crédit ne peut dépasser ce seuil des revenus nets du foyer.
Prenons un exemple concret : un couple gagnant au total 4 500 euros nets par mois. Leur mensualité maximale ne doit pas dépasser 1 575 euros. S’ils ont déjà des prêts en cours, même modestes, ces derniers viennent diminuer d’autant ce plafond.
Les courtiers s’appuient souvent sur plusieurs facteurs pour estimer la faisabilité d’un dossier. Outre le montant des revenus, ils examinent la durée d’emprunt envisagée, le TAEG (taux annuel effectif global), et bien sûr l’apport personnel. Entre 10 % et 20 % d’apport, le dossier inspire toute confiance à la banque.
Voici les chiffres clés habituellement pris en compte dans la simulation d’un dossier :
- Revenus nets du ménage : 4 500 €
- Seuil maximal d’endettement : 35 %
- Mensualité maximum : 1 575 €
- Durée envisagée : 20 ans
- TAEG moyen : 4,2 %
Bien au-delà de la simple addition, la banque observe aussi la marge de manœuvre une fois la mensualité déduite : le fameux « reste à vivre ». La stabilité professionnelle, la solidité de la gestion des comptes et la constance des revenus pèsent autant que les chiffres eux-mêmes.
Les conditions d’éligibilité à connaître avant de déposer votre dossier
Avant de présenter une demande de prêt immobilier, préparez-vous à affronter une vérification méticuleuse. Plusieurs critères d’éligibilité reviennent systématiquement. La stabilité professionnelle, que ce soit un CDI, une fonction publique, ou des revenus d’indépendant réguliers, arrive en tête. Il faut se munir de justificatifs solides : trois derniers bulletins de paie, avis d’imposition, parfois des relevés de compte.
Le projet immobilier en lui-même a aussi son poids. Résidence principale, secondaire ou investissement locatif, chaque catégorie oriente l’analyse, au même titre que la part d’apport personnel. Couvrir au moins 10 % du projet montre à la banque que la gestion est sérieuse.
L’état des finances, autre clé d’entrée : absence d’incident bancaire majeur, gestion saine et épargne régulière constituent autant d’arguments. Quant à la santé, elle entre en jeu via le questionnaire médical de l’assurance, avec parfois des examens supplémentaires selon l’âge ou le montant.
Plusieurs coups de pouce existent en complément du prêt classique : prêt à taux zéro (PTZ), prêt accession sociale, prêt action logement. Chacun s’accompagne de règles spécifiques, souvent conditionnées par le niveau de ressources ou la nature du bien convoité. Pour ne pas être freiné, mieux vaut anticiper les garanties attendues et réunir dès le départ tous les justificatifs.
Obtenir un crédit immobilier, finalement, relève moins du calcul automatique que d’une négociation subtile entre ressources du candidat, stabilité, et capacités d’anticipation. Ceux qui croient encore à la magie d’un chiffre unique se heurtent vite à la réalité : chaque dossier raconte sa propre histoire, et la banque y accorde toute son attention.